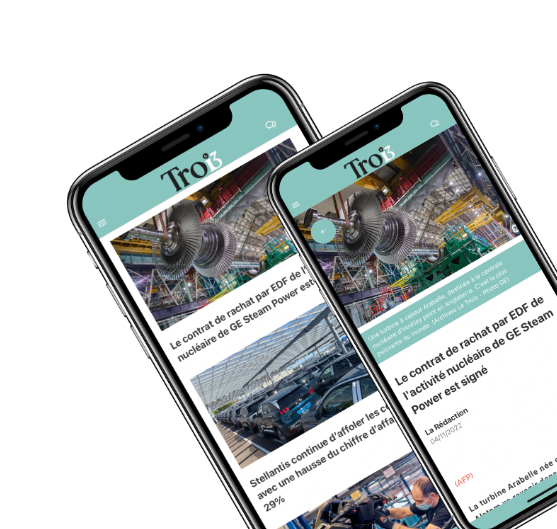Marine LEDOUX – AFP
« Les forêts de la région Grand Est sont les plus touchées de France par la hausse des températures », avec un risque d’incendie doublé d’ici 2050 et des conditions favorables aux scolytes, insectes xylophages qui ravagent ces espaces, écrivait l’ONG Réseau action climat dans son rapport publié le 19 septembre.
L’été 2022, chaud et sec, a été celui de la prise de conscience de l’augmentation du risque incendie dans cette région, ont expliqué à l’AFP plusieurs responsables chez les pompiers. Dans les Vosges, une centaine d’hectares d’espaces naturels ont brûlé en août 2022, une première.
Or, les forêts représentent plus du tiers de la superficie de la région Grand Est, 2e productrice de bois en France. Le risque de feux de forêts « devient une préoccupation », souligne le colonel Stéphane Eslinger, directeur adjoint du Sdis de la Meuse. D’été en été, les feux d’ampleur « remontent dans le nord » du pays et s’approchent de l’Est.
"Arbres morts"
Par endroits dans le département, il y aurait jusqu’à « 50 à 70% d’arbres morts », ce qui, quand il n’est pas retiré, « peut être un très bon combustible pour les feux », craint-il. La région est aussi marquée par la présence d’arbres de haute futaie pouvant créer des incendies très impressionnants avec des hauteurs de flammes de 25 à 30 mètres, « pas comme les pins du sud », souligne-t-il.
« Nos forêts ne sont pas préparées » à affronter un tel risque, selon lui. Mais les pompiers, eux, le sont. Lors de manoeuvres, des Canadairs ont pu être testés sur le lac de Gérardmer (Vosges) ou au lac de Madine (Meuse) : deux endroits où leur présence était jusqu’ici incongrue. Les Sdis forment de plus en plus de soldats du feu chaque année. Des sessions identiques pour tous, que les pompiers soient basés sur l’arc méditerranéen ou ailleurs en France, précise le commandant Frédéric Schulz, référent départemental au Sdis de la Moselle.
Désormais, toutes les préfectures du Grand Est ont mis en place des sous-commissions dédiées aux feux de forêt, rassemblant préfets, sapeurs-pompiers, responsables des chambres d’agriculture ou encore représentants de l’Office national des forêts (ONF). En Alsace, le risque d’incendie a été nouvellement considéré par les autorités du Bas-Rhin dans le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) depuis août 2023. Désormais, « le département est considéré comme territoire exposé au risque ».
"Munitions dans le sol"
Marc Sezyk, référent territorial feux de forêt à l’ONF pour la zone de défense Est (regroupant Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté), le rappelle : les feux de 2022 dans le Jura ou les Vosges n’étaient « absolument pas prévisibles ». Suite à cela, la mission d’intérêt général de l’ONF concernant les feux a été « renforcée » sur le nord et l’est du pays. Cela passe par des requêtes liées à la connaissance du terrain lors de sécheresses, ou des missions de surveillance des massifs avec des véhicules pick-up disposant de petites citernes d’eau, énumère-t-il.
Pour le commandant Schulz, l’un des défis à relever est la prévention auprès de la population: « Neuf feux sur dix sont d’origine humaine et il y a un réel besoin de déclencher une culture du risque » dans l’Est. En Moselle, des autocollants ont été apposés à l’entrée des massifs forestiers pour sensibiliser les promeneurs, tandis que des partenariats avec la chambre d’agriculture permettent de distiller des conseils aux exploitants.
L’enjeu, c’est que cette acculturation se fasse rapidement « surtout dans un contexte où on voit bien que le loisir nature, l’envie de bivouac, l’envie de passer la nuit en forêt, etc. se multiplie », note Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur territorial de l’ONF Grand Est. Il faut aussi être capable d’intervenir le plus tôt possible sur les feux, ce qui implique une connaissance de la typologie des chemins forestiers, des données totalement inexistantes il y a encore quelques années, peu à peu créées par les différents services.
L’Est, théâtre de la Grande Guerre, étudie également la « zone rouge »: des munitions cachées un peu partout dans le sol, notamment meusien, avec des territoires concernés pas encore cartographiés, et des questionnements quant à la façon dont pourraient réagir ces munitions enfouies dans le sol depuis plus d’un siècle au contact du feu.