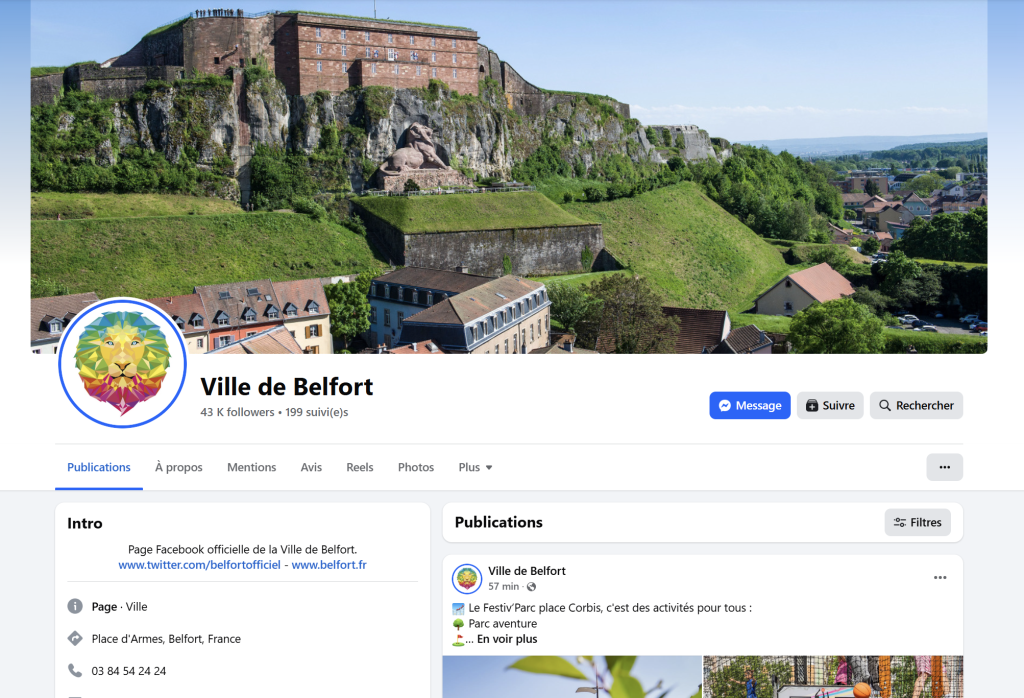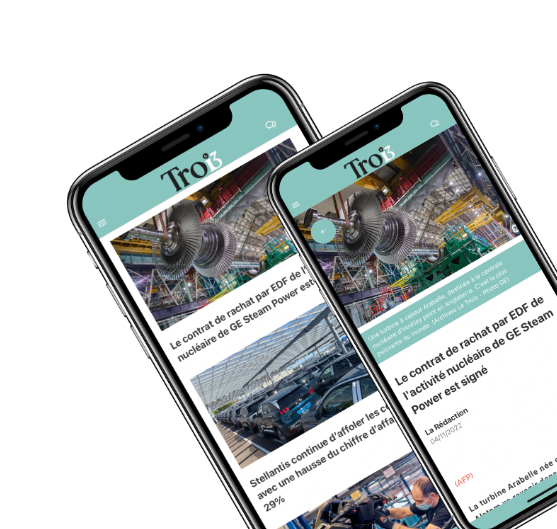Le dossier Alstom – General Electric est emblématique des rapports de force entre la France et les États-Unis. Ce lundi, des syndicats ont dénoncé les pratiques d’optimisation fiscale du conglomérat américain, au détriment des salariés et des collectivités françaises. L’occasion de s’intéresser à la notion de guerre économique. Interview de Christian Harbulot*, directeur de l’école de guerre économique, une institution créée en 1997.
Le dossier Alstom – General Electric est emblématique des rapports de force entre la France et les États-Unis. Ce lundi, des syndicats ont dénoncé les pratiques d’optimisation fiscale du conglomérat américain, au détriment des salariés et des collectivités françaises (notre article). L’occasion de s’intéresser à la notion de guerre économique. Interview de Christian Harbulot*, directeur de l’école de guerre économique, une institution créée en 1997.

Quand on parle de guerre, on parle d’armes. Quelles sont les armes de la guerre économique ?
Les armes de la guerre économiques tournent, principalement, autour de l’usage de l’information. L’arme qui vient d’abord à l’esprit vise à rechercher par tous les moyens les secrets de l’autre : l’espionnage. Pendant très longtemps, nous nous sommes focalisés sur ce terme, sans aller plus loin. C’est une vision très minimaliste, alors que la guerre économique se décline dans un tas de registres. Cela peut être un blocus maritime, un blocus continental, une capacité à aller chercher les ressources ou les matières premières là où elles se trouvent, de dissuader l’autre de le faire ou de le rendre totalement dépendant de ma manière d’aller les chercher. Cela peut être des traités de circulation maritime ou d’accès aux ports, basés sur des logiques de rapport de force, où une puissance domine et impose ses règles commerciales. Cela peut aussi être des jeux cachés dans les coulisses d’une négociation, en usant de tromperie et de l’art de la ruse afin d’utiliser au maximum les contradictions de l’adversaire. Cela peut être le développement de lobbying par le biais de la société civile, pour ne pas arriver à visage découvert, en manipulant des acteurs de cette société civile et en affaiblissant la cible que je veux atteindre. Il y a toute une palette [d’armes] qui, au cours des siècles, s’est considérablement élargie, particulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle. Avec l’émergence de la société de l’information, le champ de pratique de la guerre économique s’est énormément élargi (il évoque toutes les possibilités ouvertes par la multiplication des discours, sur les réseaux sociaux, l’art de la rhétorique, les désinformations, l’intoxication…. NDLR).

Dans la notion de guerre, il y a une notion de destruction de l’adversaire. Ici, on ne parle pas de concurrence… On parle de volonté de puissance économique, qu’elle soit étatique ou entrepreneuriale.
Absolument. Nous sommes dans des logiques qui visent à affaiblir l’autre, mais aussi à dominer l’autre. Et si possible le dominer le plus longtemps possible.


Dans quelle mesure la France est aujourd’hui dominée ?
La France s’est mise dans une position de dépendance depuis 1945, pour des raisons de politiques intérieures (le poids du Parti communiste français, NDLR). Il y avait une très grande crainte, pour une partie de la classe politique française, que le PCF obéisse aux ordres de Staline. Plusieurs membres éminents de la classe émergente de la IVe République sont allés voir les Américains et leur ont demandé de maintenir des bases en Europe, pour se protéger d’un risque de prise de pouvoir par les communistes en France. Ce n’était pas ce qui était mis en avant [pour les justifier]. On mettait en avant deux choses. La première était le danger de l’invasion de l’Europe par l’Union soviétique. Si l’Armée rouge est puissante après la victoire contre le Nazisme, elle n’avait pas les capacités logistiques pour occuper l’Europe de l’Ouest. Le deuxième argument, encore moins crédible, était de dire, en 1945, qu’il fallait lutter contre le militarisme allemand. Quand on voit l’état de l’Allemagne en 1945, ce n’était pas la priorité absolue. Quand je parle de dépendance, c’est que si on demande aux Américains une couverture militaire, cela a un prix. Nous l’avons vu apparaître dans le cadre du plan Marshall. Nous avons dû faire de grosses concessions et pas qu’au niveau du cinéma (avec l’ouverture de quotas de films américains dans la distribution des salles en France, NDLR). Nous avons dû par exemple importer du soja pour l’alimentation animale. Nous avons reconstruit partiellement notre potentiel économique grâce à des importations qui venaient du monde américain. Cette dépendance se trouvait aussi dans l’énergie ; nous dépendions des majors pétrolières américaines.

Où se matérialise cette dépendance ?
Si je reste sur les États-Unis, il est clair que toute la révolution informatique, puis numérique, nous a mis en situation de dépendance pour une raison dont nous ne parlons pas assez. À la fin des années 1950, quand le général de Gaulle a repris le pouvoir et a voulu créer une politique de souveraineté dans le domaine de l’industrie informatique (plan Calcul), les grandes entreprises françaises de l’époque ne l’ont pas suivi. Elles s’étaient déjà largement habituées à dépendre du matériel américain et ne croyaient absolument pas à la solution française : la société Bull, la délégation générale à l’informatique que de Gaulle avait créée dans le cadre du commissariat général au plan. Très vite, nous avons été complètement dépendants en matière informatique. Nous sommes devenus [aussi] dépendants dans le domaine des nouvelles technologies de l’information, jusqu’à l’économie numérique d’aujourd’hui. En Face, il n’y a rien. Nous n’avons pas cherché à créer l’embryon de quelque chose. Rappelez-vous le minitel par rapport à Internet, alors que la base de la création d’Internet, c’est quand même un chercheur français (Louis Pouzin, NDLR). Nous avons laissé ce terrain aux Américains. Arrive une autre force de dépendance, qui est la dépendance chinoise. J’ai suivi, à l’école de guerre économique, dans les années 2000, les premières discussions pour savoir si nous allions laisser rentrer Huawei en France. Ouvre-t-on notre système de télécommunication à la technologie chinoise ? À part quelques personnes de l’Administration, notamment des services de renseignements et de sécurité, il n’y avait pas de prise de conscience ou de volonté de reconnaître que ce serait une très grosse erreur.

Est-ce de la naïveté ou de l’obstination liée au dogme économique de la libre concurrence ?
Je pense que c’est plus grave que cela. Nous nous sommes habitués à être dépendants des États-Unis. Cela n’a pas empêché un certain nombre d’entreprises de vivre, de grossir, d’être au CAC 40. Nous en avons conclu, finalement, que c’était un moindre mal. Quand la Chine est arrivée, nous sommes restés dans le même état d’esprit.


En 2015, nous cédons la branche énergie d’Alstom à General Electric. Les élites politiques belfortaines, dans leur immense majorité, applaudissent. Selon vous, est-ce que cela confirme que nous sommes habitués à cette dépendance ?
Complètement ! On se disait : « General Electric, groupe mondial, c’est extraordinaire, cela ne pourra faire que du bien au Territoire de Belfort. Alstom est un groupe français, plus petit. Il ne peut que bénéficier d’être au contact d’une telle dynamique industrielle. »

Dans quelle mesure ce rachat est une illustration d’une guerre économique ?
Une des approches assez systématiques du monde américain – nous l’avons identifiée dès la fin des années 1980 – c’est d’avoir un système de captation d’informations massifs pour identifier où est l’innovation. Il n’est pas impossible que certaines des innovations d’Alstom aient pu intéresser des intérêts américains. On l’a vu avec Gemplus (cette entreprise française fabriquait des cartes à puces, NDLR). Un fonds américain en a pris le contrôle (en 2000, NDLR). Toute la technologie Gemplus a été captée, puis les Américains ont vendu Gemplus. Le comble du cynisme, c’est que Gemplus, devenu Gemalto, est rachetée par Thalès (en 2019, NDLR). Au départ, les ingénieurs qui l’ont créée étaient des ingénieurs de Thomson, devenu Thalès. Cela me fait vraiment penser à Alstom. General Electric achète Alstom et va revendre à la France (EDF doit racheter dans les semaines qui viennent l’activité nucléaire de General Electric, acquise en 2015, NDLR).

La dimension où on tord le bras à Patrick Kron – ancien p-dg d’Alstom – pour le contraindre à vendre est-elle caractéristique de la guerre économique ?
Le dispositif est réel. À partir du moment où l’on voit apparaître une synergie entre une agence de renseignements et un département de la justice (DOJ)… Le DOJ est l’arme pour faire pression afin d’obtenir un résultat. Il n’est pas dans son rôle d’appliquer la justice dans un processus de lutte anti-corruption. Ensuite, il y a toute la pression psychologique. Nous avons vu le traitement réservé à Frédéric Pierucci (ancien président monde de l’activité chaudière d’Alstom, arrêté en 2013 aux États-Unis, NDLR). Ce traitement a aussi été réservé à des cadres d’Alcatel, quelques années auparavant. Si ce n’est pas de la guerre économique je ne sais pas ce que c’est. Alcatel a eu des velléités de signer des joint-ventures avec la Chine sur des technologies que les États-Unis considéraient comme pouvant être sensibles et être captées par le complexe militaro-industriel chinois, en voie de développement. Dans ces cas-là, les États-Unis font fuiter une information par le Wall Street Journal ou un autre journal du même type, en disant : « Attention, on ne veut pas. » Avec Alstom, il s’est passé exactement la même chose. J’ai assisté à une réunion du Medef international, au moment du rachat par General Electric ; il y avait des gens bien informés, qui racontaient des anecdotes. La direction générale d’Alcatel, dans un premier temps, puis la direction générale d’Alstom, dans un second temps, n’ont pas daigné prendre en considération les menaces des États-Unis sur les risques de transferts de technologie. Les États-Unis n’avaient aucune confiance dans les Français dans la manière de conserver une technologie et de ne pas la céder aux Chinois. Ils ont mis la barre très haut pour dire stop. Ce sont des éléments d’explication très importants de ces deux affaires, au sens de la guerre économique.

Les dirigeants n’avaient-ils pas vu les signaux faibles ?
C’est pire que ça ! Ils ont vu les signaux faibles et ils n’en ont pas tenu compte. Ce que je note, c’est qu’il y a, parmi le patronat français, des gens qui n’ont pas du tout mesuré l’adversaire qu’ils affrontaient. Ni Alcatel, ni Alstom n’avaient la capacité de faire face à une riposte américaine sur des affaires de transferts de technologie. Après, il ne faut pas s’étonner qu’un rouleau compresseur se mette en place pour attaquer l’un et l’autre. Et là, nous avons deux défaites stratégiques. Alcatel a dû fusionner avec son concurrent américain et a été finalement absorbé. Pour Alstom, c’est pareil.

Que doit-on faire ?
Il faut éduquer ! Il faut donner des points de repère. Il faut mener un travail de pédagogie. Si ce travail était mené de manière plus large, la direction générale d’Alcatel et celle d’Alstom auraient bien mesuré l’amplitude des rapports de force. Et qu’ils étaient absurdes d’aller contre les Américains sur le territoire chinois, parce que les Français ont la réputation de transférer leur technologie aux Chinois ; on l’a vu avec la centrale de Daya Bay en matière de centrale nucléaire. Quand nous avons transféré cette technologie aux Chinois, comme par hasard, ils ont commencé à vendre au Pakistan des pièces qui rentraient dans le périmètre de l’approvisionnement en pièces détachées de la centrale de Daya Bay, qu’ils achetaient en double ou en triple. Nous ne donnons pas au monde de l’ingénieur le b.a.-ba de ces grilles de lecture. Et c’est vrai aussi dans les écoles de commerce.


Pendant très longtemps, l’économie était perçue non pas comme un monde de guerre mais comme un monde de concurrence. Aujourd’hui, plusieurs intellectuels, comme Graham Allison, estiment qu’une guerre est possible entre Chine et États-Unis, justement sur cet affrontement économique. L’économie a toujours été un élément motivant de faire la guerre. N’est-ce pas aujourd’hui un moyen de faire la guerre ?
Les deux. La lecture de l’histoire humaine démontre que, souvent, dans l’affrontement entre A et B, l’intérêt économique est au cœur de l’affrontement. Rome contre Carthage, c’est le commerce sur la Méditerranée. Et c’est le cœur de l’affrontement. Ce n’est pas Hannibal contre Scipion l’Africain. Plein de cas similaires sont du même ordre. Aujourd’hui, la Chine et les États-Unis sont interdépendants. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont interdépendants que c’est cela va garantir la paix. Combien de fois va-t-il falloir rappeler qu’en 1914, le premier client de la France, c’était l’Allemagne. Et vice-versa. Cela n’a pas empêché la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ne peuvent pas admettre qu’une puissance comme la Chine les dépasse. Si cela devenait le cas, ça créerait un effondrement de tout ce qui sous-tend les rouages de leur puissance. Le dollar n’aurait plus la même valeur ni la même représentation au niveau mondial. Dès que l’on touche à la monnaie, on touche aux fondations d’une puissance économique. Pour le reste, c’est pareil… Si on découvre que la technologie militaire chinoise est supérieure à la technologie militaire américaine. Si on découvre que les Américains ne peuvent pas empêcher les Chinois d’attaquer Taïwan… Ce serait terminé pour les États-Unis. Ensuite, c’est comme un château de cartes. Le vrai risque aujourd’hui, c’est que les États-Unis n’arrivent pas, pour l’instant, à contenir la pression économique chinoise sur le monde. Et s’il n’y arrive pas, il va bien falloir qu’il cherche à tout prix un moyen de stopper la Chine. Et c’est là que nous entrons dans une période excessivement dangereuse… Le moyen de stopper la Chine, c’est de la provoquer ou c’est d’aller sur des terrains politico-militaires. C’est le bon sens de le dire. Mais les gens ne veulent pas y croire. Nous avons encore des [entrepreneurs], dans le monde économique, qui se précipitent en Chine en se frottant les mains, pour faire des bonnes affaires. Je lisais dans un journal, en venant ici (au mois d’octobre, au forum Reconstruire, à Belfort, NDLR), qu’il y avait un slogan pour la Tech française de partir à la conquête de la Chine. On ne peut pas partir à la conquête de la Chine ! Elle ne veut pas se faire conquérir. Les Chinois feront du business si nous avons quelque chose qu’ils n’ont pas inventé. Ils l’achèteront, le prendront ou le pilleront. Mais il ne faut pas croire qu’ils vont dépendre de nous durablement sur une ligne technologique. Je ne comprends pas que l’on puisse sortir ces énormités en 2021. Et le vrai problème est là : nous n’avons pas aujourd’hui une culture générale basique qui tempère nos mouvement. Lors d’une réunion, des entités ont commencé à dérouler des plans en direction de la Chine. Je leur ai dit : « Attention. S’il y a réellement une tension entre les États-Unis et la Chine un peu plus élevée qu’en ce moment, tous vos plans vont s’écrouler comme des châteaux de cartes. Et vous êtes prévenus. Si vous continuez à appliquer vos plans sans tenir compte de ça, nous allons nous revoir. » La lucidité, c’est d’avoir au départ des points de repères. Aujourd’hui, nous n’enseignons pas ces points de repères.
- Cette interview a été réalisée le 20 octobre 2021, à Belfort, à l’occasion du forum national Reconstruire une industrie française, dont Le Trois était partenaire (retrouvez ici tous nos articles).