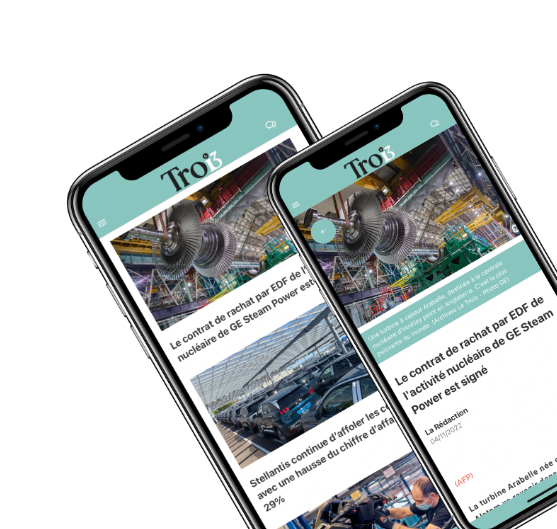De quel postulat est parti votre ouvrage ?
Je suis avocat au bureau de Paris. J’ai commencé à réfléchir à l’ouvrage « L’Etat hors la loi, logique des violences policières » en me fondant sur les centaines de dossiers que je traite depuis vingt ans. Au bout d’un moment, alors qu’on a la tête dans le guidon en permanence, on a envie de comprendre mieux les choses pour faire avancer les dossiers. J’ai commencé à méditer sur ces violences, j’ai eu besoin de prendre un temps de recul ne serait-ce que pour savoir pourquoi on défend cela. Est-ce qu’il n’y a pas un effet de focale à force de traiter beaucoup de dossiers de violences policières ? À partir de là, j’ai lu énormément de livres sur la violence, sur l’Etat, pour essayer de comprendre ce que signifiait cette violence et d’où elle venait, de quel droit.
J’ai aussi voulu informer la population, car dans ces affaires, il y a une vraie guerre de communication. Notamment pour dissimuler les affaires de violences policières. En tant qu’avocat, on le voit alors que la plupart des gens ne le voient pas. Voici pourquoi cela est devenu un besoin absolu que d’écrire ce bouquin.

Comment définir le terme de violence policière, parfois réfuté ?
J’identifie trois ensembles qui permettent de définir les violences policières : les violences ethno-raciales, qui s’expriment dans les quartiers populaires, sur des personnes issues de l’immigration, de pays anciennement colonisés par la France. Cette population a une histoire particulière avec une police particulière, avec des modes d’opération spécifiques. Un ensemble qui conserve, pour moi, la ségrégation sociale de ces quartiers populaires anciennement immigrés.
Le deuxième ensemble concerne les personnes qui s’expriment politiquement : les militants. Le maintien de l’ordre dans les manifestations. Ces dernières années, il y a eu une explosion des violences graves. On a pu observer des mutilations, des éborgnements. Pendant le mouvement des Gilets Jaunes, cela a explosé. Il y a eu des mains arrachées, par les grenades, les LBD 40 qui ont causé beaucoup de dégâts. En regardant dans le radar, j’ai passé plus de temps dans les hôpitaux qu’au tribunal à ce moment-là.
Troisième ensemble : les tirs mortels contre des véhicules en mouvement. Là aussi, on assiste à une explosion du nombre de morts tués de la police dans ce que la presse appelle des cas de refus d’obtempérer. La question c’est « Pourquoi ? » Il y a une augmentation manifeste entre 2016 et 2017, et avec l’arrivée de l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure qui permet d’ouvrir le feu en cas de refus d’obtempérer. Un texte qui est arrivé au même moment qu’un mouvement de colère pour les policiers. Un moment d’émotion intense, avec des policiers qui avaient été visés eux aussi.

Y a-t-il des degrés différents de violences selon les types de manifestation ? Gilets jaunes ? Retraite ? Agriculteurs ?
Le maintien de l’ordre varie selon le type de population qu’il a en face. Les Gilets jaunes étaient une population en cours de précarisation, des classes moyennes inférieures qui ont eu peur de devenir pauvres, globalement, qui travaillaient, qui n’avaient pas l’habitude des manifestations, qui se refusaient une issue politique. On a opposé à cela de l’anti-démocratie et de la violence. Pourquoi à ce moment ? Pourquoi cette population ? Je crois qu’à ce moment-là, nous avions un pouvoir politique extrêmement fragile, faible. Sans une grande légitimité dans la population. Selon des chercheurs, plus le pouvoir politique est faiblement légitime, avec une faiblesse d’adhésion, plus la violence s’exprime sur la population. Cela s’est vérifié à ce moment-là.

Lors des manifestations d’agriculteurs, la violence contre les biens a été particulièrement intense, avec des incendies proches des préfectures, avec des bâtiments publics soufflés par des explosions. Des actes que le procureur de la République n’hésite pas quelques fois à qualifier de terroristes. Là, rien. Pas de force de l’ordre violente, une discussion permanente, une volonté d’éviter l’escalade. Ce moment du mouvement des agriculteurs a permis de comprendre que la violence est une affaire d’Etat et une décision politique. Il n’y a que l’Etat et les préfectures qui vont déterminer le degré de violence dans les manifestations.
Finalement, lorsqu’on compare le traitement par les forces de l’ordre des mouvements dans les quartiers populaires, et qu’on y oppose d’autres types de manifestation, on remarque aussi qu’il y a une volonté de traiter moins bien les populations moins importantes, parce que noirs et arabes, parce qu’issus des quartiers populaires, parce que ne votant pas, parce que ne constituant pas une force politique ou électorale intéressante.

Vous avez commencé à traiter ces dossiers il y a 20 ans. Est-ce que les problématiques étaient les mêmes ?
Quand j’ai écrit ce bouquin, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas d’éléments de statistiques pour comparer et déterminer s’il y avait eu une augmentation véritable des violences policières. Ce qui a beaucoup aidé : les vidéos avec les téléphones portables. Mais cela a aussi créé un effet de focale sur les violences policières à partir du moment où les personnes ont pu filmer et diffuser sur les réseaux sociaux. Je n’arrivais donc pas à répondre à cette question.
Ce que je sais, c’est que cela a toujours existé. Dans les moments où le pouvoir est fragile, il y a une expression de la violence. Depuis peu, nous avons des chiffres qui nous permettent d’évaluer l’évolution de cette violence. Il y a eu Allo Place Beauvau qui a permis de chiffrer les violences pendant une période donnée. Mais il y a surtout eu le média Politis qui a obtenu des chiffres que personne n’arrivait à obtenir jusqu’ici, du ministère de la Justice, sur la période de 2016 à 2021 et sur la base des enquêtes ouvertes sur des personnes dépositaires de l’autorité publique en matière de violences.
L’augmentation sur cette période est de 57%. C’est plus que significatif. Avec cela, on sait que cela n’a pas baissé. Le problème, avec ces chiffres, est qu’ils ne reposent que sur les enquêtes ouvertes par le procureur de la République. Cela crée un filtre important.

Trop peu de personnes portent plainte, selon vous ?
Il y a un effet dissuasif à porter plainte, qui consiste à dire qu’on aura des soucis si on porte plainte et surtout que cela n’aboutira pas. Il est aussi aujourd’hui très difficile de porter plainte contre un policier. Les commissariats refusent, ce qui est illégal. Il y a donc une vraie impunité en matière de violences policières. Les choses évoluent, mais c’est encore vrai.
Lorsque les personnes portent plainte, au bout de la chaîne judiciaire et de la chaîne pénale, il y a les juges. Ils sont indépendants mais ils travaillent grâce aux policiers. Ils jugent leurs dossiers grâce un rapport pénal, rédigé et organisé par des policiers. À Paris, ils ne se connaissent pas. Mais au niveau local, il y a l’effet de proximité et de connaissance. C’est extrêmement périlleux pour un juge de taper sur son outil de travail.
Ces difficultés contribuent à une dégradation de la confiance entre les citoyens et l’Etat. Mais la démocratie est en jeu. Les policiers sont des gardiens de la paix. Lorsque l’Etat utilise une violence contre ses propres concitoyens qui s’expriment simplement dans leur droit constitutionnel, on a un vrai sujet démocratique. C’est dramatique. Cela peut notamment expliquer une désaffection pour les élites politiques, pour la politique en général et peut-être en partie expliquer l’orientation vers l’extrême-droite ; c’est l’une des raisons.

Existe-t-il des solutions ?
Il y en a plein. Pour moi, la solution est de déposer une multitude de plaintes et le faire systématiquement. C’est important pour faire comprendre qu’il n’y a pas d’impunité, que ça peut évoluer. L’arme puissante pour cela est le droit, il peut changer la donne, même s’il reste à faire un travail de pédagogie important auprès des juges. Mais cela évolue, l’explosion des violences policières nous a permis d’avoir un dialogue plus précis et permanent avec eux. Désormais, beaucoup plus d’affaires arrivent à terme, ce qui est important pour rétablir l’équilibre des pouvoirs et faire comprendre aux policiers qu’il n’y a pas d’impunité.