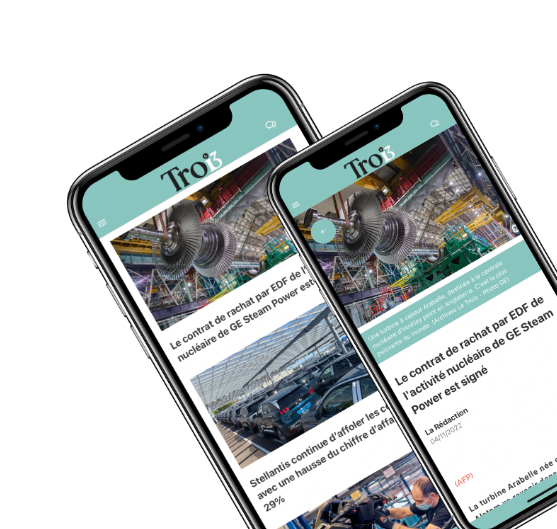La France compte 46 000 monuments historiques, dont 3752 en Bourgogne-Franche-Comté (et pour les trois départements sur lequel s’étend le nord Franche-Comté : 56 dans le Territoire de Belfort ; 491 dans le Doubs ; 381 en Haute-Saône).
À l’échelon national, 45% d’entre eux sont la propriété de collectivités locales, dont la moitié sont des communes. Un patrimoine foncier et bâti assorti d’une obligation de conservation « difficilement soutenable », selon une étude que vient de publier la Chambre régionale des comptes (CRC) de Bourgogne-Franche-Comté associée à sept autres chambres régionales (Bretagne, Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire et Provence – Alpes Côte d’Azur), ce qui a permis de disposer d’un échantillon de 60 collectivités.
À ces 46 000 monuments historiques s’ajoutent 45 000 églises et chapelles non inscrites et non classées, et qui ne relèvent pas du patrimoine dit « réglementé ». L’étude publiée à la veille des journées du patrimoine s’intitule « Les collectivités territoriales face aux enjeux de leur patrimoine monumental et Bourgogne – Franche-Comté ».
La difficulté pour les collectivités de remplir leur obligation de conservation revêt plusieurs aspects : des difficultés structurelles à assurer un entretien courant de leur patrimoine, le coût d’entretien élevés, parfois une disproportion entre la taille de la commune et le patrimoine dont elle est propriétaire. Parallèlement, de grands projets nationaux (comme la reconstruction de Notre-Dame) peuvent avoir des incidences négatives sur les projets patrimoniaux locaux, notamment un effet d’aspiration des entreprises compétentes dans le domaine du patrimoine : elles sont alors moins disponibles pour des chantiers de plus petite taille et les coûts, selon la loi de l’offre et de la demande, peuvent augmenter.
Des co-financements pour parvenir à 45% de reste à charge
Dans ce contexte, les aides de l’État pour les projets de rénovation du patrimoine s’avèrent décisives : ce sont elles qui déclenchent des co-financements des Régions et des Départements, permettant de faire baisse le reste à charge pour les communes à 45% en moyenne.
Mais là encore se dresse un écueil : celui de la baisse actuelle des financements publics. La piste des financements privés, via le mécénat, reste une exception, même si la Saine d’Arc-et-Senans a pu obtenir 30% des produits d’exploitation. La Chambre régionale des comptes souligne en revanche l’intérêt du Loto du patrimoine qui « constitue une source de financement plus récente qui peut constituer un véritable effet levier ». Elle cite en exemple Baume-les-Messieurs où « le financement de la restauration de l’abbaye, dont les travaux, évalués à près de 4,5 M€, seront pris en charge à hauteur de 58 % au titre des recettes publiques, laissant un reste à charge à hauteur de 1,9 M€, dont près de 16 % seront pris en charge au titre du loto du patrimoine. Le loto constitue un complément aux outils développés par la Fondation du patrimoine. »
Juste conserver ou mettre en valeur ?
Au-delà du constat de difficultés présenté lors d’une conférence de presse mercredi, les magistrats de la Chambre régionale des comptes esquissent des pistes pour y faire face. Le panel des 60 collectivités de huit régions différentes leur a permis d’identifier quelques « bonnes pratiques ». Par exemple d’anticiper les avis des architectes des bâtiments de France et le dialogue avec l’Etat, de façon à dégager une vision pluriannuelle permettant de programmer les dépenses. Ou encore de mutualiser les ressources techniques à l’échelon intercommunal ou via des associations de sauvegarde du patrimoine. A défaut de pouvoir assumer la charge de certains monuments, les magistrats ont évoqué aussi la piste de la cession à une fondation spécialisée dans ce domaine.
La question se pose aussi pour les communes de la destination de leur patrimoine : simple conservation ou valorisation ? En cas de valorisation, pour quel usage ? La Chambre régionale des comptes voit deux grands axes dans la perspective d’une valorisation : l’attractivité touristique ou l’aménagement du territoire.
A contrario, elle a identifié des points de vigilance : une surestimation des recettes envisagées après la rénovation et l’ouverture au public ; des changements d’affectation qui peuvent être des sujets délicats et engendrer des débats ; une nécessaire rigueur dans la gestion des structures. La reconversion d’un bâtiment historique pour un suage communal peut aussi représenter un risque, car les coûts de fonctionnement s’avèrent parfois sous-estimés.
Retrouvez ici notre carte interactive des événements des Journées du patrimoine dans le nord Franche-Comté.
Le poids des contraintes
Le taux de vacance des logements est deux fois plus élevé dans les espaces protégés que dans ceux qui ne le sont pas, constate la Chambre régionale des comptes. Ce rapprochement entre taux de vacance et contraintes l’amène à penser qu’elles peuvent être des freins à la rénovation pour les propriétaires. En termes d’espaces protégés, elle cite l’exemple de la boucle du Doubs, à Besançon qui relève de quatre zones de protection différentes, ce qui multiplie d’autant les contraintes normatives. « Concilier protection de l’environnement et conservation demeure complexe et coûteux, illustre ainsi la Chambre régionale des comptes. À Besançon, dans le cadre du projet de « grande bibliothèque », l’architecte des bâtiments de France a imposé que les panneaux photovoltaïques s’intègrent dans la continuité des toitures de la boucle. Cette prescription a pour conséquence d’utiliser des panneaux non standard, notamment par leur couleur, et génère un surcoût de 20 %, ainsi qu’une production moindre de moitié. »
« En 2016, la loi LCAP a eu pour objectif de simplifier les zonages de protection existants », souligne la CRC. Elle estime toutefois que sa mise en œuvre reste trop lente.