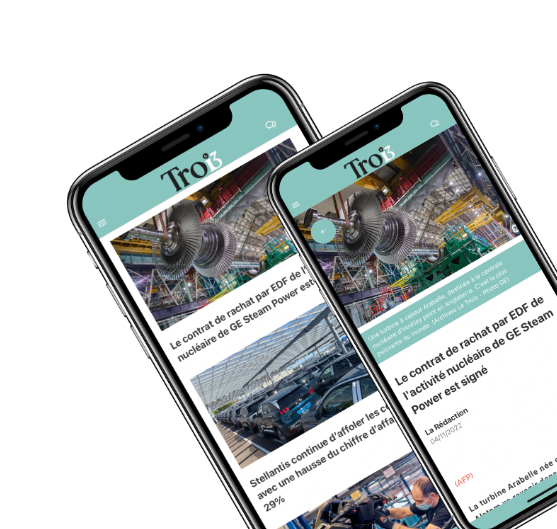Depuis quand l’entreprise Cristel s’est-elle engagée dans la démarche de la décarbonation et quel en a été le déclencheur ?
Depuis toujours, Cristel est engagée. Mon élément déclencheur est antécédent à mon arrivée chez Cristel, quand j’ai vu le film Soleil vert(1). Je pense que je n’ai fait que révéler ce qui existait chez Cristel. Le fait que mes parents étaient agriculteurs jusqu’à ma naissance a joué aussi. Et il y avait en Allemagne tout un sujet sur les pluies acides et des forêts qui étaient dévastées.

Quelles sont les principales actions de décarbonation et, plus largement, de protection de l’environnement, qui ont été entreprises par Cristel ?
Le premier engagement fort, c’est en 1995-1997, avec la réhabilitation du site de fabrication. Nous avons choisi de rester sur le site de fabrication pour ne pas laisser une friche derrière nous [en reconstruisant] un bâtiment neuf, ce qui aurait été beaucoup plus pratique et beaucoup plus fonctionnel par rapport à nos contraintes industrielles.

En quoi cet élément joue-t-il sur la décarbonation ?
Le fait de réhabiliter un site est toujours moins impactant pour l’environnement que de refaire un site ex-nihilo, en réartificialisant le sol. En 1995, nous avons aussi commencé le rechapage des poêles antiadhésives. Nous changeons le revêtement anti- adhérent d’une poêle qui peut encore vivre, mais dont le revêtement est le seul élément usé.


En se faisant l’avocat du diable, peut-on dire que le rechapage est aussi un argument commercial ?
Oui. Mais au départ, nous perdions de l’argent. Maintenant, nous sommes à l’équilibre parce que nous nous sommes organisés industriellement. C’était [une opération] très complexe à mener, parce que la société qui déposait le revêtement était basée dans le centre de la France. Le produit devait faire un aller- retour pour être rechapé. Maintenant, tout est intégré.

D’autres engagements à citer ?
À partir de 2007, nous avons commencé à utiliser de l’électricité issue de sources renouvelables, avec un engagement particulier par l’intermédiaire d’EDF : nous nous approvisionnions en électrons issus de sources renouvelables en payant plus cher. Nous n’avons rien contre le nucléaire, mais quand nous pouvons faire autrement… Le soleil, le vent et les courants d’eau sont là pour nous apporter une certaine énergie : utilisons- la pour faire tourner notre usine.


Est-ce aussi un critère de choix pour les fournisseurs ?
Nous questionnons nos fournisseurs. Après, il est parfois difficile d’avoir toutes les certitudes quant à leurs engagements, parce que nous ne sommes pas non plus des gros donneurs d’ordre. En aucun cas, nous ne pouvons les contraindre, en leur disant : « Si vous ne faites pas ça, nous ne travaillerons pas avec vous. » Par contre, si nous avons le choix entre plusieurs fournisseurs et qu’il y en a un qui est plus vertueux que l’autre, évidemment, nous allons vers celui-là. Par exemple, sur notre matière première, nous nous approvisionnons principalement auprès d’Aperam. Il s’engage à utiliser 87 % de produits recyclés dans sa matière première. Et c’est fabriqué avec une matière première européenne, avec une énergie principalement issue du nucléaire, décarbonée, contrairement à des matières premières qui pourraient venir de Chine. Elles seraient beaucoup moins chères, mais seraient fabriquées d’une part, avec des matériaux beaucoup moins recyclés et, d’autre part, avec une énergie principalement issue du charbon.

Est-ce que vous avez pu mesurer les répercussions de ces dispositions ?
Nous faisons notre bilan carbone depuis quelques années. Nous n’avons pas calculé ce que cela nous a fait gagner. Par contre, nous mesurons où nous pouvons encore nous améliorer. Nous avons par exemple changé notre approvisionnement d’aluminium, à la suite de notre premier bilan carbone, parce que nous nous sommes rendus compte que l’incidence était lourde sur notre bilan et que nous pouvions faire avec un aluminium plus vertueux. Nous le payons plus cher, mais c’est plus intéressant.

Est-ce que d’autres actions sont en projet ?
Des projets, nous en avons plein, comme rapatrier de la production, pour l’instant sous-traitée par manque de capacité. Nous allons aussi mettre en service des panneaux photovoltaïques, sur le toit du nouveau bâtiment.

Justement, ce nouveau bâtiment logistique répond-il aussi à ces exigences ?
Ce nouveau bâtiment est éco-conçu. Nous avons travaillé avec un bureau d’études spécialisé, le bureau « Ouvert », spécialisé dans « l’écolonomie ». Il nous a accompagnés pour définir le bâtiment le plus respectueux de l’environnement possible, ce qui veut dire que nous avons fait des choix de matériaux plus vertueux. Notre charpente est en bois. Du point de vue environnemental et du bilan carbone, le bois est plus respectueux, même si les poteaux sont en béton : nous avons fait le calcul jusqu’au bout ! Le bois est aussi plus chaleureux et résiste mieux au feu. D’autre part, ce bâtiment est sur-isolé : nous sommes allés au-delà des isolations convenues normalement, pour avoir un bâtiment plus agréable à travailler, moins chaud en été, plus confortable en hiver et que nous devrons moins chauffer. Nous avons aussi étudié pas mal d’alternatives, comme la géothermie. Pour cette dernière, nous avions un problème de rentabilité : c’était un million d’euros d’investissement supplémentaire pour un bâtiment qui est déjà très gourmand financièrement. Nous n’arrivions pas à la financer ni à la rentabiliser. Nous avons opté pour des pompes à chaleur. Il y a aussi un point particulier sur ce site : nous sommes sur une ancienne friche industrielle, qui date de 1826. Et force est de constater que, à cette époque, ils n’avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd’hui pour préserver l’environnement. Beaucoup de choses finissaient au fond de l’usine, brûlées sur place. Quand on donne un coup de pioche, on tombe sur des vestiges pollués que nos ancêtres ont laissé. Nous avons dépollué et nous cherchons encore à avoir les accompagnements de l’État qui nous reviennent normalement pour financer cette partie. Ce sont 900 000 euros que nous ne pouvons pas mettre sur de l’investissement en machines pour faire de la réintégration, pour augmenter la capacité de production et pour mettre des gens devant les machines pour créer de l’emploi. C’est frustrant.

Quand on prend des mesures de décarbonation, cela a un coût. Est-ce que ça fait courir un risque financier à l’entreprise et comment parvenez-vous à le maîtriser ?
Il y a des investissements ultra rentables, comme le recyclage de la chaleur des compresseurs. En six à dix-huit mois, l’investissement est rentable. On récupère l’air chaud qui sort des compresseurs pour pouvoir chauffer les ateliers. Aujourd’hui, 40 ou 60 % de la surface de production est chauffée par nos compresseurs. Le deuxième système de récupération de chaleur fatale a été travaillé avec Ananké (start- up belfortaine, NDLR) ; nous récupérons la chaleur fatale qui sort des brûleurs de nos tunnels de cuisson de revêtements anti-adhérent pour produire de l’électricité ou de l’air comprimé.



Certains systèmes sont rentables et d’autres ne le sont pas…
Certains systèmes sont rentables à beaucoup plus long terme et d’autres ne le sont pas du tout. La géothermie n’était pas rentable dans notre cas, parce qu’il fallait faire des puits à 150 ou 200 mètres de profondeur. Il en fallait potentiellement une dizaine, vu la nature du sol. Cela représentait un coût gigantesque. Un autre investissement que nous avons fait et qui n’est pas rentable du tout, ni financièrement, ni en termes environnementaux – j’en suis quasiment sûr maintenant – c’est de travailler en boucle fermée pour l’eau du process de fabrication. Nous récupérons l’eau qui, normalement, part à l’égout, pour la retraiter et la réintégrer dans notre process. Au final, nous consommons des produits chimiques afin qu’elle soit à nouveau utilisable. Pour produire ces produits chimiques, il a fallu de l’eau ; pour moi, la quantité d’eau nécessaire pour les produire est supérieure à ce que nous économisons avec la boucle fermée.

Comment maîtrise-t-on l’éventuel risque financier ?
Déjà, nous travaillons à long terme. C’est une vision de bon père de famille qui fait qu’un investissement aujourd’hui, même s’il est rentable dans dix ans, n’empêche pas que nous l’engagions. Quand nous avons engagé la récupération de chaleur fatale avec Ananké, le système devait être rentable au bout de dix ans. Nous n’avons pas hésité. Et l’évolution du coût de l’énergie nous a donné raison puisqu’aujourd’hui, il est rentable plus rapidement que prévu. Pour être une entreprise vertueuse, il faut être une entreprise. Il n’y a d’entreprises vertueuses que d’entreprises performantes. C’est déjà la performance de l’entreprise et sa viabilité qu’il faut regarder. Ensuite, on peut regarder les valeurs et la vertu qu’on exprime à travers ça.


Si vous deviez donner trois conseils à une entreprise industrielle qui voudrait se lancer dans la décarbonation ?
Commencer par des choses très simples : la c’est un truc d’une simplicité enfantine ! Ensuite, se rapprocher de sociétés qui ont un peu de bouteille pour partager des astuces et des expériences, bonnes ou mauvaises. Enfin, mobiliser l’ensemble du personnel : il y a des gens prêts à s’investir spontanément dans ce domaine.

Certains discours consistent à dire que les normes, notamment dans ce domaine, sont des freins au développement de l’entreprise. Qu’en dites-vous ?
C’est vrai et c’est faux. C’est bien d’avoir des normes, parce que ça oblige à un cadre. Mais je pense que le système normatif français est devenu tellement complexe que personne n’est capable de le maîtriser, y compris les agences dont c’est le métier. Quand on voit les interprétations possibles d’une norme ou le fait de ressortir une autre norme vieille de 50 ou 100 ans et qui n’a plus lieu d’être dans le contexte actuel, je trouve que le système a besoin d’être simplifié et amélioré.

Pour Cristel, est-ce que cela peut être bloquant ?
Non. Mais les bras nous en tombent, parfois, quand nous voyons ce qui nous est demandé, reproché… Ça fait partie de la joie de l’entreprenariat français !
(1) Soleil vert, sorti en 1973, de William Fleicher, se déroule sur une Terre qui ne peut plus nourrir l’homme. Celui-ci est alimenté à son insu par des gélules fabriquées à partir d’humains.
Article paru dans le hors-série print « Comment décarboner l’industrie », publié en mai 2025 par Le Trois. Acheter la version numérique (4,5€) : https://letrois.info/kiosque/comment-decarboner-lindustrie/ | pour acheter la version papier (7€), sur demande à : redaction@letrois.info