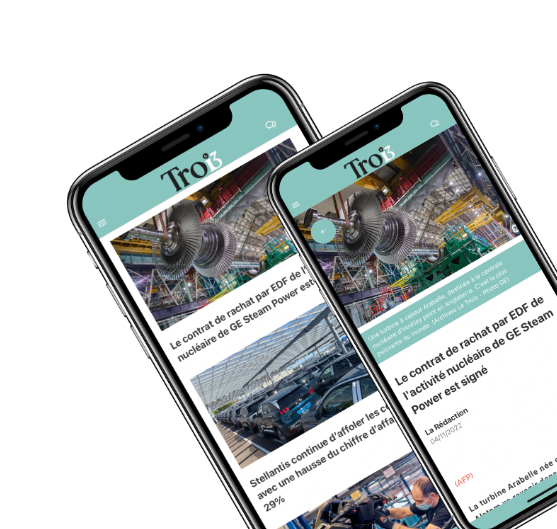Une centaine d’élus a pris part, lundi 14 octobre, à Andelnans, à une réunion d’informations concernant le zéro artificialisation nette (ZAN, proposée par le sénateur Les Républicains (LR) du Vaucluse Jean-Baptiste Blanc, rapporteur du groupe de suivi des dispositions législatives et réglementaires relatives à la stratégie de réduction de l’artificialisation des sols ; le groupe a rendu son rapport début octobre. Face à l’inquiétude montante quant à l’application de la loi, un groupe de suivi a été constitué, menant un travail de six mois. 70 personnes ont été auditionnées et 1 400 ont répondu à une consultation en ligne.
Le ZAN est prévu par la loi Climat et résilience, approuvée en 2021. Le zéro artificialisation nette sera la règle en 2050. Si l’on artificialise d’un côté, il faut renaturer de l’autre. Au-delà de cette échéance à moyen terme, la loi prévoit déjà de ralentir, d’ici 2030, l’artificialisation des sols, c’est-à-dire la conversion d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Le sénateur LR ne remet pas en question l’importance de limiter l’artificialisation. Il rappelle dans une note distribuée aux élus que la France perd chaque plus de 20 000 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestier, soit environ 28 000 terrains de football, près d’un par commune française. Mais la loi, telle qu’elle est prévue, n’est pas sans générer quelques doutes. Des préoccupations « renforcées par la pénurie de foncier », indiquait-il à ce sujet sur LinkedIn, « et ses répercussions sur la production de logements, le développement des infrastructures pour la transition écologique » et l’implantation d’activités économiques et industrielles ».
L’actuelle loi est simplement « arithmétique », s’étonne Cédric Perrin. « Elle profite aux gros [territoires] qui ont de l’ingénierie et un poids politique », ajoute-t-il Une situation qui se fait au détriment des territoires « ruraux et périphériques », déplore encore Cédric Perrin. « On n’a pas de gestion différenciée, c’est monolithique », critique-t-il par ailleurs. Autre sujet impensé majeur : « le financement », assure le sénateur du Vaucluse, que ce soit en termes d’ingénierie, d’investissement ou de fiscalité, une fiscalité locale qui a plutôt tendance à encourager l’artificialisation, reconnaît-il.

« Faire confiance aux élus »
La mécanique de ralentissement de l’artificialisation prévue par le ZAN est, qui plus est, paradoxale. La surface à artificialiser autorisée d’ici 2031 est calculée par rapport à la surface artificialisée entre 2011 et 2020. De fait, une commune qui a été sobre n’aura pas de crédit. Une qui « à bétonner », en aura. « C’est la prime aux mauvais élèves », s’insurge Cédric Perrin. « On fabrique des Gilets jaunes, redoute Jean-Baptiste Blanc. C’est une machine à fabriquer de la colère. »
À l’été 2023, le Sénat avait arraché une évolution du texte. Un minimum d’un hectare avait été sacralisée pour chaque commune et les constructions liés à des projets d’envergure nationale ou européenne étaient sortis du calcul ; ce sont 12 500 hectares qui sont disponibles d’ici 2031. Les projets sont identifiés par l’État, un élément qui n’est pas sans faire réagir Jean-Baptiste Blanc, qui regrette un certain centralisme. Ces projets ne témoignent pas de « gestes d’aménagement du territoire », observe-t-il.
Dans l’application de la loi, « il faut plus de souplesse », estime Jean-Baptiste Blanc. « On n’atteint pas un objectif si on n’associe pas les élus », met en garde Jean-Baptiste Blanc. Selon lui, les élus sont prêts à renaturer et à réhabiliter les friches. « Mais quels sont les outils ? Quels sont les financements ? » questionne-t-il, évoquant, localement, le parcours du combattant de Didier Vallverdu, maire LR de Rougemont-le-Château qui engage la réhabilitation de la friche TEEN.
Jean-Baptiste Blanc ne veut pas remettre en cause l’objectif de cette loi. Le groupe de suivi a tendu la main au nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui semble prêt à revoir cette loi, selon le sénateur du Vaucluse. L’idée est bien de garder les objectifs de réduire l’artificialisation des sols. Mais il veut « rebaptiser » la loi, introduire la notion de « santé des sols » afin de qualifier leur qualité, mais aussi « casser la planification » au profit « de la contractualisation d’une trajectoire jusqu’en 2050 ». D’ajouter, finalement : « Il faut faire confiance aux élus. »
1,3 ha de friche à réhabiliter à Rougemont-le-Château
L’entreprise Teen (Techniques et équipements nouveaux) a fermé ses portes à Rougemont-le-Château, dans le nord du Territoire de Belfort, en 1999, indique Didier Vallverdu, le maire de la commune, en poste depuis 2014. Elle était spécialisée dans la fabrication de résistances blindées pour du matériel de chauffage. « Ce sont 1,3 ha installé au cœur du village », replace l’édile, qui s’est rapidement attelé à sa réhabilitation après son élection. « J’ai toujours pensé que c’était la pierre angulaire du développement de la commune », confie Didier Vallverdu. Le projet de réhabilitation se construit autour des aînés. La future friche accueillera une résidence senior, avec 25 logements, 5 pavillons, de plain-pied, sûrement avec Territoire Habitat. Une seconde partie sera octroyée à un promoteur qui proposera des logements « en accession à la propriété ». Si le projet est attractif sur le papier, il n’en est pas moins complexe à lancer. « C’est une friche avec des bâtiments délabrés, amiantés et un sol pollué, détaille Didier Vallverdu. Personne ne voulait l’acheter », indique-t-il. L’unique option : que la collectivité porte le projet. Mais par où commencer ? Comment le financer ? Le défi est colossal. « Ce fut l’une des difficultés majeures que de savoir par où prendre le problème », confie-t-il. Le coût s’élève à 1,3 million d’euros ; 80 % du financement est assuré par des subventions, que l’équipe municipale a été glanées avec abnégation.