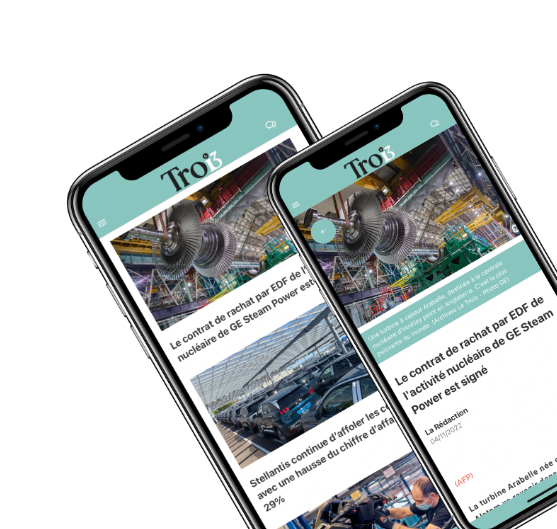Sénateur du Territoire de Belfort et membre de la délégation française à l’assemblée parlementaire de l’Otan, Cédric Perrin expose son analyse sur l’Otan, l’Europe et les conséquences sur l’élection présidentielle face à la situation ukrainienne.
Sénateur du Territoire de Belfort et membre de la délégation française à l’assemblée parlementaire de l’Otan, Cédric Perrin expose son analyse sur l’Otan, l’Europe et les conséquences sur l’élection présidentielle face à la situation ukrainienne et l’invasion russe. Le parlementaire est également vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat.

Quel est le rôle de l’Otan dans la crise ? Est-ce assez efficace ?
Efficace, elle n’a pas à l’être pour le moment car aucun pays de l’Otan n’a été attaqué. Mais il va falloir tirer des leçons de ce qui s’est passé et de ce qui s’est dit. Beaucoup exposaient que l’Otan était en mort cérébrale. L’on voit bien que ce n’est pas le cas. Ce conflit met en lumière que ceux qui sont sous le parapluie de l’Otan ont quand même une certaine sécurité : l’utilité de l’Otan n’en est que renforcée. En tout cas, elle a montré tout son sens et son intérêt dans une situation qui a fait croire à certains que nous allions vivre éternellement dans les dividendes de la paix. Désormais les choses ont été mises en perspective.

Et qu’en est-il du rôle de l’Europe ?
Même si je suis profondément européen, je ne suis pas pour l’Europe que nous sommes en train de construire. J’ai d’ailleurs été le premier à dire que l’Europe n’était pas à la hauteur de l’enjeu et j’ai souvent regretté que les décisions ne soient pas prises quand il aurait fallu le faire. La semaine dernière, j’avais envisagé deux théories : Celle où l’Europe prendrait ses responsabilités en agissant très vite, en ayant une vision stratégique. Ou alors celle où elle n’y arrivait pas, et la France aurait dû prendre ses responsabilités.
Finalement, ce qui me satisfait vraiment, c’est que l’Europe aura plus avancé en trois jours qu’en 30 ans. Evidemment, c’est sur le dos d’une crise terrible et d’une guerre catastrophique, mais la construction européenne s’est solidifiée.

Quels ont été les actes qui ont solidifié l’Europe ces trois derniers jours ?
L’unanimité a été trouvée très facilement sur différents sujets : notamment sur le sujet des sanctions. Le Swift, ce n’était pas donné d’avance pour tout le monde. Car beaucoup de pays vont en pâtir et en subir les conséquences. Ce choix n’est pas neutre.
C’est aussi les décisions prises par l’Allemagne. Il y a un peu plus d’une semaine, l’Allemagne se questionnait sur le fait d’envoyer des casques. Avant-hier, elle a décidé d’envoyer des lance-roquettes et d’investir 100 millions d’euros. Ce sont aussi des avancées pour nous, pour une construction d’une Europe industrielle de la défense. Pour investir, enfin, dans du matériel. Jusqu’ici, ces projets étaient au point mort car les Allemands ne sont pas moteurs sur ces sujets. Désormais, ils ont montré que cela est une priorité. Il y a eu une révolution psychologique de la part du chancelier Olaf Scholz qui a montré qu’il pouvait faire oublier Angela Merkel rapidement alors qu’il y a quelques jours, il était très peu présent sur le sujet.
La Finlande a pris des décisions majeures, la Suisse aussi qui commence à soutenir les sanctions européennes. Nous sommes dans une révolution culturelle. Je trouve que tous les pays ont été à la hauteur et continuent de l’être.


La manière dont se déroule cette guerre est plutôt classique. Qu’est-ce que cela veut dire pour le futur ?
Comme le dit le chef d’Etat-major, nous sommes dans une guerre de haute intensité. Nous sommes fort heureusement sous le parapluie nucléaire, ce qui pousse les Russes à des affrontements classiques. Par rapport à l’Ukraine, les Russes prennent en tenaille les Ukrainiens entre Kharkov et la Crimée pour couper l’armée ukrainienne en deux : c’est une technique classique. Rien de nouveau sous le soleil. Par contre, l’on se rend compte que la guerre des robots est encore loin.
Un principe a été inventé par Barack Obama (président des États-Unis d’Amérique de 2008 à 2014, NDLR) il y a quelques années, qui consiste à dire qu’aucun soldat ne devrait être sur le terrain. Sauf que cette technique ne marche pas. Sans affrontement, sans conquête territoriale, il n’y a pas de victoires. Pour avoir tout ça, il doit y avoir des affrontements sur le terrain. Le problème de l’Ukraine, dans cette guerre, c’est désormais de savoir où s’arrêtera [Vladimir] Poutine.

A-t-on les moyens d’imaginer, aujourd’hui, la manière dont cela s’arrêtera ?
Le problème, c’est que nous n’avons pas la même rationalité que Poutine. Nous sommes éduqués par 70 années de démocratie derrière nous. Nous raisonnons avec des esprits qui n’ont pas eu de pertes territoriales conséquentes en 1991, qui n’ont pas connu les conséquences du traité de Varsovie. Et donc, nous ne raisonnons pas de la même manière que lui. Fatalement, nous n’avons pas vu ce qui allait arriver. Il était impossible d’imaginer que les choses se passeraient de cette manière-là. Nous rentrons dans le champ de l’inconnu.
« La campagne électorale est terminée »
Pour Cédric Perrin, il ne faut pas se leurrer, la problématique de la guerre a mis fin à la campagne électorale. « Nous le paierons dans deux ou trois ans. Une fois de plus, la campagne aura lieu sans débat. Quand les personnes ne peuvent pas exprimer ce qu’elles veulent, quand il n’y a pas d’explications sur ce qui va se faire après, cela posera forcément de vrais problèmes .»