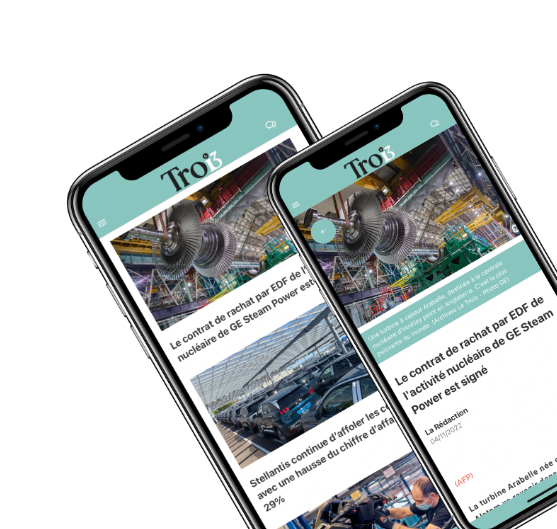Loéva Claverie
« Notre État de droit prend l’eau. Et comme pour les bateaux dans la Manche, il y a des politiques qui donnent de sérieux coups de couteau dedans pour que ça prenne l’eau. » Des bateaux d’immigrés troués par la police à Calais aux menaces proférées à l’encontre de l’accueil de réfugiées afghanes à Belfort, le contexte politique et sociétal français est éprouvant pour les défenseurs des droits de l’Homme.
À Belfort, les membres de la section de la Ligue des droits de l’homme ont même été amenés à s’interroger sur leur utilité. « Fin juin, on s’est posé des questions », relate Évelyne Petit, membre de la LDH 90. Créée en 1898 à l’occasion de l’affaire Dreyfus, l’association a pour but de « faire valoir les droits des personnes qui n’y ont pas accès, quelle que soit leur nationalité », rappelle-t-elle. Or, plusieurs éléments viennent entraver leur action.
À commencer aujourd’hui par le tournant politique que prend la France et que les militants de la Ligue regardent avec inquiétude. « À cause des circulaires Retailleau, même les personnes qui sont dans leurs droits n’y ont pas accès, pointe Évelyne Petit. Faire avancer les dossiers est très compliqué. Malgré les preuves et les documents justificatifs, les OQTF (obligation de quitter le territoire français, NDLR) tombent. Parfois, elles tombent même alors que les dossiers sont encore en cours d’instruction. »
La LDH dénonce une « fabrique des sans-papiers », causée par l’Administration française. « Les demandes d’instruction ne sont pas répondues à temps, les papiers sont redemandés. Il n’y a pas assez de monde en préfecture et on met du frein dans certaines. En attendant, les gens sont sans droits parce que le dossier est en cours d’instruction. »
Un rempart contre la haine
Conséquence : des situations de plus en plus compliquées à démêler pour les personnes concernées, mais aussi pour les membres de la LDH, qui accompagnent les dossiers. « Cela crée du stress, de l’angoisse et de la fatigue pour les bénévoles », s’inquiète Évelyne Petit.
Depuis peu, de nouveaux profils toquent à la porte de la section : des personnes avec des troubles de santé mentale. Une catégorie de gens à laquelle la LDH n’était jusqu’alors pas confrontée. « La LDH a pour principe d’accueillir tout le monde et ces personnes viennent nous voir car elles considèrent qu’on est les derniers à pouvoir les aider. On voit bien que les services publics sont à la peine et qu’on est un rempart, mais on n’est pas formés, regrette Évelyne Petit. Quand des gens ont accès à des droits et qu’on n’arrive pas à les faire valoir, ça décourage les bénévoles. Certains en viennent à considérer qu’ils seront plus utiles en distribuant des repas aux Restos du cœur. »
Ce principe d’accueillir les personnes sans distinction, que la LDH porte en étendard, ne plaît pas non plus à tout le monde et l’association doit faire face à « l’incompréhension » de ses détracteurs. « Aujourd’hui, il y a notamment tous ces mouvements d’extrême droite qui trouvent dans les populations immigrées le bouc émissaire pour les accuser [de tous les] problèmes en France. Pour d’autres, c’est l’écologie. » Lorsque la LDH a annoncé un événement convivial pour l’accueil de trois femmes ayant fui la persécution des Talibans en Afghanistan, elle ne s’attendait pas à la violence des commentaires qui ont suivi, sur les réseaux sociaux. « Ça ne nous dérange pas de tenir nos positions, précise Évelyne Petit, mais on craint l’action violente. »
L’association doit alors apprendre à composer avec ces menaces. Présente sur Facebook et Instagram, elle veille « à sa position médiatique, pour ne pas attirer des gens qui ont perdu le sens commun. Mais on marche sur des œufs. » Cela implique de passer par les réseaux internes, de moins communiquer publiquement sur les actions et d’en faire des plus ponctuelles, pour ne pas laisser le temps à leurs détracteurs de s’organiser. Au risque d’attirer moins de monde et indirectement moins d’adhérents.
12 juillet, une journée de commémoration
La LDH – comme d’autres associations – dépend des adhésions pour vivre. Elles représentent 80% de son budget ; les 20% restants sont versés par l’Etat. Mais la « crise du bénévolat » qui secoue le monde associatif la met à l’épreuve. Menacée de dissolution par l’ancien Premier ministre, Gérald Darmanin, il y a trois ans, la LDH avait vu son taux d’adhésion bondir. Plus 15 % dans toute la France. À Belfort, le groupe est passé de 55 à 70 adhérents. « Ce ne sont pas les adhérents les plus actifs, mais ils ont adhéré pour nous soutenir, en réponse aux menaces gouvernementales, explique Évelyne Petit. Ils pensent que la Ligue est une lumière qui ne doit pas s’éteindre. »
Une lumière qui brille depuis 127 ans maintenant. La LDH a été créée pour défendre Alfred Dreyfus, un officier juif accusé à tort de trahison, pour fait d’espionnage. Apartisane, l’association s’est réjouie de l’annonce par Emmanuel Macron de la création d’une journée de commémoration, le 12 juillet, pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. « La famille était très contente, précise Évelyne Petit. C’est fondamental de comprendre comment on peut en arriver là. Comment on peut nier des droits et laisser cours à ce racisme et à cet antisémitisme. »
Une phrase qui fait écho à des situations observées aujourd’hui. D’autant plus lorsque la LDH se trouve empêchée dans son rôle. L’association a mis en place, depuis les manifestations des Gilets Jaunes, des observateurs des droits de l’homme, pour observer comment se passe le maintien de l’ordre public par les forces policières. Neutres, passifs et identifiables, ils avaient reproduit ce rôle en 2022 lors de la manifestation à Sainte-Soline. Mais lors de la manifestation contre l’autoroute A69, les 5 et 6 juillet, les membres de la LDH ont été empêchés d’assurer leur rôle d’observateurs. Aujourd’hui, comme il y a 127 ans, les droits de l’homme ne sont pas acquis. Les défendre est un combat du quotidien.