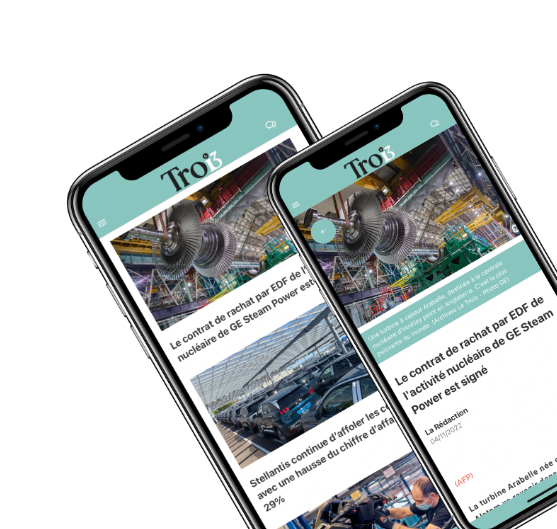Une campagne a été organisée dans le nord Franche-Comté pour mesurer le radon dans les habitations. Pourquoi, et qu’est-ce que c’est ? Le radon est un gaz naturel radioactif, qui émane des roches et remonte à la surface. Il migre à la surface à travers les fissures et les pores du sol. À l’air libre, il est fortement dilué, mais lorsqu’il pénètre dans un bâtiment, il est susceptible de s’accumuler et d’atteindre des concentrations élevées.
Le problème : cela présente un risque sanitaire important. Le centre international de recherche sur le cancer a classé le radon comme cancérigène pulmonaire certain depuis 1987. Il constituerait le 2e facteur de risque de développer le cancer du poumon après le tabac (environ 10% des décès par cancer). Le risque s’accroît avec la concentration et la durée d’exposition. Mais aussi avec le tabac : le risque est multiplié par 20.
Face aux risques, une cartographie existe, réalisée en 2010 par l’institution de radioprotection et de sûreté nucléaire. Mais malheureusement, l’évaluation globale ne suffit pas à connaître sa propre exposition au sein de son foyer. Sur une même commune et même entre deux bâtiments distincts, la concentration peut être très différente. La seule manière de connaître son exposition : la mesurer.
La campagne évoquée plus haut a été organisée dans le nord Franche-Comté pour mesurer cette concentration. Elle a été proposé par le Pôle métropolitain et l’agence régionale de santé, dans les communes classées en zone 3. C’est à dire à fort potentiel radon. On pouvait retrouver Anjoutey, Auxelles-Haut, Chaux, Giromagny, Sermamagny, Saulnot, Valdoie, ou encore d’autres communes des Vosges du Sud, du Grand Belfort et du pays d’Héricourt. Dans le nord Franche-Comté, 20 communes ont accepté de participer à l’enquête.
Les habitants ont pu récupérer des dosimètres dans leurs communes et les ont installés dans les pièces où ils vivent le plus (salon, cuisine, chambre), au rez-de-chaussée, car c’est là que se concentrent les plus forts taux de radon. Ils ont été posés pendant deux mois minimum, en période hivernale (du 15 septembre au 30 avril). En tout, 282 dosimètres ont été installés, 212 ont été retournés et 211 ont été analysés en laboratoire.
Offemont, commune exemplaire de la campagne
Le vendredi 19 octobre, les habitants d’Offemont ont été invités à participer à une restitution publique après cette campagne menée d’octobre 2022 à octobre 2023. Offemont est considéré comme « un challenger de ce type de test », avec 39 foyers qui ont participé à cette enquête, loin devant la deuxième commune, Rougegoutte, qui a installé 20 dosimètres. Plusieurs foyers se trouvent au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 100 becquerels par mètre cube (unité de mesure qui permet de mesurer le nombre de désintégrations par seconde, et ce dans un mètre cube d’air). La moyenne à Offemont se place à 148 Bq/m3. Un chiffre qui n’inquiète pas plus que cela. « Si le résultat de la mesure est inférieur au niveau de référence de 300 bq/m3 […], aucune action particulière n’apparaît nécessaire, à l’exception des bonnes pratiques en termes de qualité de l’air intérieur dans le logement », détaille le Pôle métropolitain.
À Offemont, seul trois foyers dépassent ce seuil. Pourquoi ? Cela dépend des foyers. Cela dépend de la manière dont ont été construits les bâtiments où les Offemontois résident. Cela peut-être dû à une mauvaise isolation des sols, aux matériaux, à un système de ventilation défaillant qui ne permet pas d’évacuer le radon, ou encore à une mauvaise aération. « On voit par exemple que les maisons en pierre et granit sont plus affectées », détaille une experte sur place.
Avec les résultats obtenus dans la commune, la restitution publique a surtout eu pour but de sensibiliser aux bons gestes. Bien aérer, 15 minutes par jour même en hiver pour éliminer le gaz.
Pour ceux qui auraient de plus fortes concentrations, les experts conseillent de vérifier le système de ventilation de la maison, l’appartement et de vérifier l’isolation des sols. Cela peut passer, dans le pire des cas, par une étanchéification de l’interface entre le sol et le bâtiment. Désobstruer les entrées d’air, les bouches d’extraction. Entretenir la ventilation. Mais aussi une isolation des espaces intermédiaires comme les caves et les vides sanitaires, ainsi que cacher les jours des portes qui séparent les sous-sols du rez-de-chaussée. Colmater les fissures, les trous dans le sol, étanchéifier les joints, permet aussi selon les experts de limiter la casse.